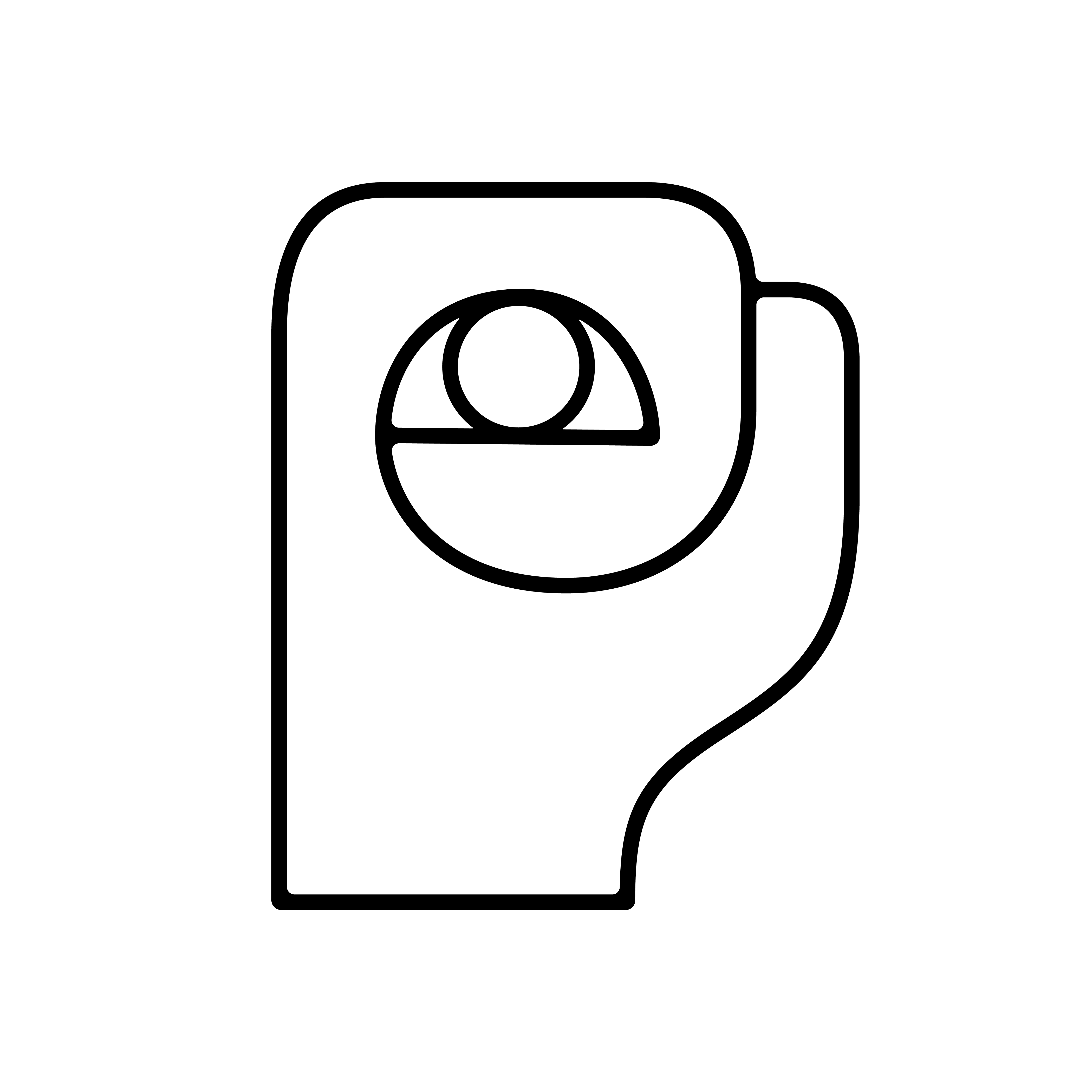Nicole Brenez
Violence historique, argumentation visuelle
Ali au pays des merveilles de Djouhra Abouda & Alain Bonnamy
Ali au pays des merveilles, essai pamphlétaire musical sur l’immigration en France des années 1970, décrit une violence systémique. Son ouverture documente factuellement le caractère sanglant du racisme, à l’aide d’un long et terrible déroulant en forme de réquisitoire qui recense 31 meurtres perpétrés contre des Arabes au cours de 1975, année qui voit accéder Marcel Bigeard (officier accusé d’avoir torturé pendant la guerre d’Algérie) au rang de secrétaire d'État à la Défense. Sur fond de xénophobie et de diffamation figurative, Ali au pays des merveilles travaille d’abord à établir des faits, à décrire des situations et conditions d’existence, à restituer des images refoulées, à saturer la perception et l’intellection de données simultanément sensibles et logiques. Ouvriers sortant du Trou des Halles alors en chantier comme des rescapés d’un tremblement de terre, terrassiers enfoncés dans leurs tranchées tandis que passent les bourgeoises affairées à leurs emplettes… nombreux sont les motifs à la fois réalistes et symboliques d’un travail d’exhumation des corps et d’entrée dans le visible.
Pour restituer simultanément la violence structurelle et celle des situations singulières, le film systématise les formes visuelles et sonores du conflit. Il ne s’agit pas seulement de mettre les images en lutte avec les représentations dominantes, mais d’utiliser à plein les ressources cinématographiques de confrontation possible entre les images :
- le montage parallèle, manifestation la plus simple de la brutalité de la lutte des classes ;
- le split-screen, spatialisation du conflit, qui l’objective un peu plus ;
- le flicker, qui le porte au comble de la violence sensible ;
- la surimpression et plus généralement les outils visuels de la rémanence, qui permettent à des images anciennes d’affleurer à la faveur d’un écho, à la manière dont un banal contrôle d’identité à la Goutte-d’Or fait revenir violemment les images des massacres du 11 octobre 1961 (1) et des massacres français en Algérie ;
- le surcadrage, ici sorte de split-screen naturel qui, au sein d’un même champ, fait coexister deux mondes – telle cette palissade de part et d’autre de laquelle s’ignorent passants parisiens et ouvriers terrassiers, comme s’il suffisait de cadrer correctement le monde pour que la lutte des classes & des histoires s’y analyse elle-même.
Les conflits entre texte et image, entre son et image, entre les sons, entre les images, culminent dans le retour d’un même plan : celui des Champs-Élysées en début et en fin de film. De cliché topographique lors de sa première occurrence, métamorphosé, éclairé, mis en perspective (les bidonvilles à 3 kilomètres), enrichi, conflictualisé, il revient ultimement en image-écran que nous avons désormais tous les moyens de déchirer.
Ali au pays des merveilles participe d’une écriture du trauma. L’essai ici refuse de se faire diagnostic et de participer même salutairement à toute forme de réparation, de conciliation et d’accord. Sa violence est celle du hurlement, proportionné à la violence de l’oppression sur :
- les dépossédés : Algériens spoliés de leurs terres par la colonisation et forcés à l’émigration ;
- les exploités : petites mains des Trente « Glorieuses », travailleurs épuisés dans le métro du petit matin, éboueurs ramassant les déchets à mains nues ;
- les bafoués : unes racistes des hebdomadaires français fascistes qui – j’en témoigne – dégorgeaient tranquillement leur haine aux devantures de tous les kiosques à journaux du pays ;
- les démunis : populations parquées dans les bidonvilles boueux de la région parisienne (Nanterre, la Courneuve…) ;
- les esseulés : sombre silhouette finale en marche dans une périphérie autoroutière inhumaine, privée de tout y compris d’une fraternité ;
- les angoissés : petite fille d’avance en révolte contre le misérable destin professionnel qui lui est réservé (un BTS de couture) ;
- les frustrés : grappes masculines attroupées devant les portes des bordels sinistrement fameux pour leur abattage ;
- les bannis du visible : corps au travail qui parsèment la ville comme autant de petites figurines que personne ne considère ;
- les refoulés : victimes niées, oubliées, parfois diffamées, de la guerre d’Algérie (le terme est encore interdit en France à l’époque) mais aussi du crime d’État d’octobre 1961 à Paris ;
- les morts : stèles des soldats musulmans arrachés aux colonies et tombés au front « pour la patrie ».
Comme les plans, ces catégories s’apposent, s’adjoignent et se surimpriment, on voit bien que chaque protagoniste, chaque figurant, chaque silhouette pourraient incarner plusieurs d’entre elles. Elles fusionnent d’une certaine façon dans la sombre figure finale, à la fois documentaire et allégorique, solitaire et collective, située localement et représentative d’une condition globale réservée aux peuples du Tiers-Monde, réelle et fantomatique. Le chant kabyle de Djamel Allam, « Mara d'yughal/Quand il reviendra », récit de ce que ses parents offriront au fils émigré lorsque celui-ci enfin retournera au pays (« On lui donnera un cheval afin qu'il traverse les comtés / On lui ajoutera un fusil pour qu'il puisse chasser les perdrix… ») ajoute une dimension revendicative et solaire à la mélancolie terrible qui règne dans ces plans urbains et pluvieux.
Contre toutes ces apories et diffamations, le film déborde d’énergies visuelle, sonore, rythmique, figurative, logique. Celles de :
- l’éloquence parfois torrentielle des orateurs, en particulier « M », le locuteur principal (Djouhra Abouda le désigne ainsi dans un entretien de 1978) (2)
- la diversité des langues et des accents ;
Et puis des :
- différentiels de vitesse (image fixe/accéléré/ralenti, montage court/plan-séquence/jump-cut/flicker), qui volatilisent le principe même d’un déroulement orthonormé ;
- différentiels d’angle, focale, objectif (recours massif peu commun au fisheye) qui volatilisent le principe même d’une vision orthodoxe ;
- plans en caméra portée ou travellings qui semblent se lancer en apnée dans un monde qui ne sera jamais suffisamment décrit et le remettre en mouvement ;
- plages musicales qui ironisent (la Marseillaise réarrangée) ou déterritorialisent les images ;
- visages et des gestes dont les présences vibrantes pulvérisent les dénis, oublis, dénigrements.
« Toutes les images ont été filmées comme des coups de poing » , déclare Djouhra Abouda (3). Mais ce travail plastique, rythmique et agogique se met au service d’une argumentation visuelle qui joue avec virtuosité des processus de déduction et d’induction. Ceux-ci culminent peut-être dans le « jeu d’images » – comme on dit « jeu de mots » –, par lequel le titre d’un journal raciste, « Nos rues livrées à la pègre arabe », se voit raillé, raturé, discrédité par un plan sur les mains d’un ouvrier immigré pavant avec soin une rue parisienne. Ali au pays des merveilles élabore une contre-image aussi sensible et sensuelle que rationnelle, d’une part grâce aux informations explicites délivrées par les mots et les chiffres qui arrivent de partout, sous de nombreuses formes et parfois en même temps (déroulants verticaux et horizontaux, tirades orales, dialogues, chants…) ; d’autre part grâce à la richesse des significations implicites que nous sommes conviés à déduire des conflits organisés par le montage. Mais la véracité la plus incontestable du film provient sans doute autant des faits exposés et des motifs décrits que de la virulence avec laquelle ceux-ci surgissent dans la représentation, à la manière dont la rugosité (4) d’un cri atteste l’intensité d’une douleur.
Face à une situation aussi flagrante d’injustice historique, économique et sociale, les films tant de fiction que documentaire se multiplient en France dans la seconde moitié des années 1970 (5). Parmi les plus importants qui concernent spécifiquement l’immigration en France, mentionnons les magnifiques œuvres essayistes de Med Hondo (Soleil Ô, 1967, Les Bicots-nègres, vos voisins, 1973), de Sidney Sokhona (Nationalité : immigré, 1976, Safrana ou le droit à la parole, 1978), le Mohammed Diab, comment et pourquoi on tue un travailleur algérien (1974) de Daniel Julien, le travail du Collectif Mohammed en Super 8, ou encore – peut-être le plus proche plastiquement d’Ali pour certains travellings réinvestis de musique arabe –, le documentaire Fos-sur-mer (1972) de Peter Nestler. Mais avec Ali au pays des merveilles, jamais la rage n’a été aussi belle et brillante, jamais un pamphlet ne nous a autant appris sur les violences de la négation, sur les puissances de l’affirmation descriptive, sur les pouvoirs de la conflictualité cinématographique.
Pour ne pas en finir, trois remarques factuelles.
- Dans leur entretien de 1978, Djouhra Abouda et Guy Hennebelle attribuent tous deux une durée de 75 minutes à Ali au pays des merveilles. Et en effet, un long métrage n’aurait pas été de trop pour illuminer le paysage politique de sa flamboyante acuité. En l’absence de cette version longue, que grâce soit rendue à l’association Talitha pour son travail de restauration et de remise en circulation de ces 59 minutes qui en remontrent à leur présent mais au nôtre tout aussi bien.
- Trente ans plus tard, alors même que le chef d’œuvre de Djouhra Abouda & Alain Bonnamy restait tout à fait oublié et quasiment invisible, un autre cinéaste-musicien s’inspira d’Ali au pays des merveilles pour, à son tour, en découdre avec les violences policières de son temps : le rappeur Hamé, dans son court-métrage La Disette du Corbeau (2008).
- On ne peut s’empêcher de penser que si les critiques, historiens et programmateurs de cinéma faisaient leur travail aussi correctement que les ouvriers du bâtiment kabyles ou les éboueurs maliens, autrement dit, si les admirables films de Djouhra Abouda & Alain Bonnamy, de Sidney Sokhona, ou encore l’essai global de René Vautier Déjà le sang de mai ensemençait novembre (1985) étaient devenus les classiques du cinéma qu’ils devraient être, peut-être un champ transactionnel pour favoriser des dialogues possibles aurait-il été établi, peut-être les fossés culturels n’auraient-ils pas continué à se creuser, peut-être n’aurions-nous une extrême-droite raciste aux portes du pouvoir et régnant de toute sa toxicité triomphante sur les débats politiques aujourd’hui en France. Peut-être, bien sûr, certainement que je rêve au pays des images.
Paris, janvier 2022.
1. Ce sont les photographies d’Élie Kagan, que Jacques Panijel utilisa dans Octobre à Paris (1962).
2. Guy Hennebelle, « Djouhra Abouda : l’émigration est bleue comme une orange ! », in « Cinémas de l’émigration », CinémAction n°8, été 1979, p. 130.
3. Id., p. 131.
4. « La présence de rugosité dans le signal acoustique induit une augmentation des réponses cérébrales dans l’amygdale, région sous-corticale impliquée dans la réaction au danger. » Luc H. Arnal, « Le cri humain : une niche acoustique particulière », Med Sci (Paris), Volume 32, n° 6-7, juin–Juillet 2016, https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2016/07/medsci20163206p539/medsci20163206p539.html#R5
5. Cf l’inventaire établi par Guy Hennebelle dans son Guide des films anti-impérialistes, Paris, éditions du Centenaire, 1975, chapitre « Les immigrés en Europe de l’Ouest », pp. 10-35.
︎Article écrit pour la programmation “Creation is a political protest. The cinema of Djouhra Abouda and Alain Bonnamy” au CCCB à Barcelone, prévue le 30 janvier 2022, dans le cadre de Xcèntric 2022. A lire en espagnol ou en catalan ici.
Nicole Brenez est historienne et théoricienne du cinéma, Professeur des universités à l’Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3, directrice du Département « Analyse et Culture cinématographique » à La Fémis, programmatrice des séances « Cinéma d’avant-garde / Contre-culture générale » à La Cinémathèque française.
En 2000, elle y co-programme la retrospective Jeune, dure et pure. Une histoire du cinéma d’avant-garde et expérimental en France (suivie de l’ouvrage du même nom), le seul programme qui -avant sa récente restauration- sortira Ali au pays des Merveilles de sa longue invisibilité, pour une séance unique.
Elle a également participé à l'édition scientifique des textes de Jean Epstein, Masao Adachi, Edouard de Laurot. Avec Philippe Grandrieux, elle a fondé la collection « Il se peut que la beauté ait renforcé notre résolution », série de portraits de cinéastes révolutionnaires oubliés ou négligés par l'histoire du cinéma. Elle a travaillé avec Chantal Akerman, Jean-Gabriel Périot, Marylène Negro, Jocelyne Saab, et travaille actuellement pour Jean-Luc Godard et Jacques Kébadian.
A lire : MANIFESTATIONS : Écrits politiques sur le cinéma et autres arts filmiques, par Nicole Brenez (De l’incidence éditeur, 2020).
En 2000, elle y co-programme la retrospective Jeune, dure et pure. Une histoire du cinéma d’avant-garde et expérimental en France (suivie de l’ouvrage du même nom), le seul programme qui -avant sa récente restauration- sortira Ali au pays des Merveilles de sa longue invisibilité, pour une séance unique.
Elle a également participé à l'édition scientifique des textes de Jean Epstein, Masao Adachi, Edouard de Laurot. Avec Philippe Grandrieux, elle a fondé la collection « Il se peut que la beauté ait renforcé notre résolution », série de portraits de cinéastes révolutionnaires oubliés ou négligés par l'histoire du cinéma. Elle a travaillé avec Chantal Akerman, Jean-Gabriel Périot, Marylène Negro, Jocelyne Saab, et travaille actuellement pour Jean-Luc Godard et Jacques Kébadian.
A lire : MANIFESTATIONS : Écrits politiques sur le cinéma et autres arts filmiques, par Nicole Brenez (De l’incidence éditeur, 2020).
---
︎ Plus d’informations sur le film
︎ Carnet de Recherche Note 1 : Ali au Studio Galande
︎ Carnet de Recherche Note 2 : Ali à la Cinémathèque algérienne
︎ Carnet de Recherche Note 1 : Ali au Studio Galande
︎ Carnet de Recherche Note 2 : Ali à la Cinémathèque algérienne